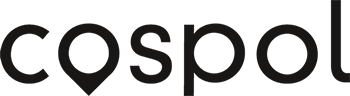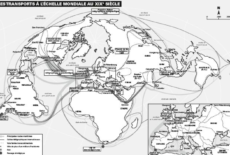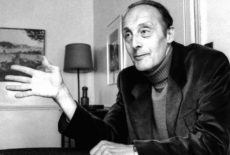Cospo-votation : No Billag
En matière de campagne, celle de l’initiative No Billag fut d’une rare intensité : loin de nous l’idée d’en étendre encore la longueur. Cependant, COSPOL s’engageant à proposer des débats sur l’actualité politique, il convenait d’en organiser un regroupant quelques habitués (rescapés) des plateaux politiques. Nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre intervenants : deux « pour » l’initiative, et deux « contre ». Le premier camp se composait de Nicolas Jutzet, responsable de la campagne No Billag pour la Suisse romande, membre du comité d’initiative et jeune PLR neuchâtelois, et Jean-François Rime, conseiller national UDC et président de l’USAM. Le second, celui des opposants, comprenait Pascal Crittin, directeur de la RTS, et Daniel Brélaz, conseiller national Vert, ancien syndic de la ville de Lausanne[1].
Partant que les divers arguments ont été largement traités[2], je me suis concentré sur une prémisse récurrente dans ce débat, mais pourtant peu explicitée dans la presse : la vision de la liberté. Somme toute, j’essaierais brièvement de répondre à la question « d’où l’intervenant parle-t-il ? » par une analyse de l’utilisation discursive de la liberté, en dégageant le sens auquel les intervenants se référaient implicitement ou explicitement. Ce terme correspond à ce qu’Uwe Poerksen définit comme des « mots plastiques »[3], autrement dit des mots qui signifient ce que le locuteur veut signifier, indépendamment d’un quelconque accord autour du sens littéral. Le signifié noie, étouffe, déborde le signifiant. « Quand je prononce devant vous les mots liberté, peuple, bourgeois, socialisme, révolution, démocratie, pouvez-vous vous flatter de comprendre ce qu’ils signifient pour moi ? »[4] Donc, ce court travail essaiera de rendre compte du sens mis dans les énonciations de la liberté, tout en le croisant avec les informations biographiques des intervenants.
Jean-François Rime
Ici, trois informations biographiques importent particulièrement pour comprendre sa position sur l’initiative : son poste de directeur de l’USAM, son statut d’entrepreneur (patron de trois moyennes entreprises) et sa casquette politique UDC. Ces différents aspects individuels découlent sur une appréciation économique et politique particulière de l’initiative. Économiquement, la liberté d’entreprise n’est pas respectée, en particulier celle des moyennes entreprises. Les petites entreprises — en tout cas celles avec un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 CHF — seront exonérées de la redevance comme l’a annoncé Mme Leuthard. D’un autre côté, la redevance des entreprises sera plafonnée à 35 000 CHF. C’est incohérent pour M. Rime, voire une pure manœuvre politicienne. Les moyennes entreprises paient pour les grandes et les petites, ce qui reviendrait par exemple à 15 000 CHF pour les trois entreprises qu’il gère. D’après lui, la bonne décision viserait à supprimer la redevance pour les entreprises, car les employés la paient déjà individuellement. S’ajoute à cette critique économique une attaque politique, en particulier contre Mme Leuthard. Il sous-entend que l’UDC est entrée en campagne en réponse à l’obstination de Mme Leuthard, ne voulant pas entrer en matière en proposant un contre-projet qui aurait permis des discussions parlementaires. Autrement dit, la démarche de Mme Leuthard a empêché le débat démocratique, et nuit à la liberté politique. Faute de débat parlementaire, l’UDC se devait alors d’exporter ses arguments en dehors de l’arène politicienne. M. Rime souligne d’ailleurs que l’initiative eut le mérite de créer et étendre un débat inexistant au parlement. Pour la suite, il souhaite que les promesses de réformes tenues lors de la campagne deviennent effectives : c.-à-d. la limitation des charges pour les entreprises (augmenter la liberté d’entreprendre), une baisse de la redevance privée (augmenter la liberté de consommer), et l’ouverture d’une discussion publique sur le rôle et les contenus de la SSR (augmenter la liberté politique, c.-à-d. la démocratie).
Daniel Brélaz
Les informations biographiques à retenir en premier lieu tiennent à son engagement écologiste et ses diverses casquettes dans les conseils d’administration du secteur public ou d’entreprises fortement liées à la population suisse. Logiquement, son argument principal se base sur du protectionnisme économique. Pour lui, la liberté face à l’État, que revendique Jutzet, est une mauvaise question. La liberté d’une situation se compare à une autre situation : elle est relative. Dans un monde globalisé, l’État permet de sauver les meubles. Il reprochera d’ailleurs à Jutzet d’être un promoteur de « tous les bénéfices pour les GAFA ». À l’heure des multinationales voraces, dont la puissance égale celle des États, interdire la redevance équivaut à vendre le reste de l’audiovisuel aux géants internationaux, qui se hâteront de rentabiliser ce qu’ils peuvent au détriment des minorités, d’abord linguistiques, mais aussi locales et culturelles (les minorités des minorités). Nous assisterons donc à une diminution de la liberté relative des ménages à faibles et moyens revenus : ils ne pourront pas consommer autant qu’actuellement, car l’offre sera fragmentée, et qu’au sein de cette fragmentation, c’est les informations locales ou complexes qui deviendront soit plus chères, soit absentes. Il ajoute, vers la fin du débat : « Est-ce qu’on est tellement bon qu’on va, comme petit pays avec de petits moyens, arriver à supplanter dans les services de ce genre le reste de la planète ? {…} c’est le Petit Poucet qui se prend pour le géant ». Pour lui, cette liberté relative n’est de loin pas parfaite. Il rejoint la critique de la redevance comme taxe inégalitaire, tout le monde payant la même chose. Seulement, il insiste : dans cette initiative, cette question n’est pas posée. Pour résumer la position de M. Brélaz, nous dirons que la liberté absolue n’existe pas, qu’elle s’apprécie relativement à ce qui se perd et se gagne résultant sur un nombre de possibilités (de choix), agrégé pour toute la population. Il s’inscrit dans l’idée de la liberté pour tous, cher à la tradition sociale, dont on s’approche en limitant la liberté de ceux que l’on juge responsables de diminuer celle des autres.
Nicolas Jutzet
Il conçoit la liberté surtout en opposition à l’État, qui ne doit pas imposer la redevance aux citoyens. Ces derniers demeurent assez grands pour décider de ce qu’ils consomment. Il ajoute « que ce n’est pas à l’État d’accompagner le citoyen et de l’éduquer tout au long de sa vie ». En cela, il s’inscrit dans un libéralisme radical, proche d’une perspective libertarienne. Cependant, il refuse le qualificatif de radical en renversant la critique : c’est la situation actuelle qui se montre radicale. Il se considère plutôt comme un libérateur des citoyens. Il est difficile de ne pas y voir le modèle de l’homo œconomicus cher à l’économie orthodoxe qu’enseignent certaines écoles de commerce (où il étudie — HEC Saint-Gall — aspect biographique potentiellement important[5]), selon lequel les acteurs sociaux se caractérisent par la rationalité, le niveau d’information optimum, la maximisation du rapport coût/bénéfice et l’égoïsme. D’après lui néanmoins, les acteurs ne sont pas forcément égoïstes. Son initiative se présente comme un test « grandeur nature pour la solidarité suisse » qui n’aurait pas attendu la SSR pour exister. Le marché fonctionnerait mieux pour créer de la solidarité que la loi. Autre point important : la SSR pratique une concurrence déloyale aux autres producteurs de contenus. Les autres producteurs de contenus se débrouillent, cherchent perpétuellement à s’améliorer, alors que la SSR profiterait de revenus lui laissant une marge de manœuvre. Pour résumer, « la RTS fait peut-être un travail intéressant, mais la presse écrite et les livres aussi. Les gens, dans la vie de tous les jours, font des travaux intéressants pour rendre les citoyens plus critiques ». Il ajoute que ceux qui veulent consommer paieront plus, sans forcer le reste de la population. Sachant que 90 % de la population regarde des productions de la SSR, ils devraient pouvoir payer un peu plus pour continuer à regarder ces mêmes contenus.
Pascal Crittin
Il est en partie déterminé par son rôle de directeur de la RTS, mais aussi par le fait qu’il vienne du privé. C’est d’ailleurs l’un de ces premiers arguments : il ne s’oppose pas au marché, voire le soutien dans les secteurs économiques qu’il juge dépendants des mécanismes de l’offre et de la demande. D’après lui cependant, certains services non-rentables doivent être fournis par la collectivité. En ce sens, il entre tout à fait dans une forme de libéralisme classique que prônait par exemple Adam Smith. La collectivité, cristallisée dans nos sociétés contemporaines par l’État, doit fournir les prestations nécessaires à la vie en société, que ne peuvent pas produire le privé et le libre marché. La liberté, pour ce genre de prestations, réside dans le financement public, car, sans ce dernier, plus de services donc plus de choix. En Suisse particulièrement, l’audiovisuel se rentabilise difficilement, à cause de la division des programmes par territoire linguistiques et culturels. On ne peut faire l’économie de la question d’échelle[6]. D’où l’importance de la redevance : elle contribue à la richesse du pays, au service public, qui comme des infrastructures publiques, doit rester accessible à tous librement. Il montre bien les méfaits du processus d’internationalisation d’un secteur avec l’exemple de la presse écrite et de l’ATS[7]. En Suisse, les éditeurs de presse sont clients et propriétaires-actionnaires de l’ATS. Les journaux s’abonnent à l’ATS. Les éditeurs ont donc demandé de baisser le prix des abonnements (autrement dit de payer moins pour l’information). Mais de l’autre côté, en tant qu’actionnaires, ils demandent du profit à l’ATS. Cette sommation au profit découle sur des coupes de postes, une baisse de production ou des suppressions de journaux locaux parce que l’ATS ne pourra plus produire d’informations locales comme dans le Jura bernois[8] : en bref, ce cercle vicieux agit de manière contreproductive sur les économies régionales. Pour compléter cet argument sur les éditeurs, il ajoute que ces derniers ne veulent pas toucher de redevance, pour être libres de proposer ce qu’ils veulent, c.-à-d. faire du profit. Pour résumer sa position, nous lui laisserons la parole par sa conclusion n’hésitant pas à jouer sur un registre plus émotionnel :
« Il faut faire attention avec cette liberté de choix. Je pense que la liberté de choix, dans la vision des initiants, c’est une véritable illusion d’optique. Ce n’est pas ça la liberté. Parce que cette liberté de choix dépend, dans la loi du marché, de ceux qui décident de ce que vous avez le droit de voir, et eux, ils le décident parce que c’est rentable ou non. Si vous aviez vraiment la liberté de choix, alors pourquoi avez-vous toujours moins de journaux, de presse écrite ? Pourquoi les journaux fondent-ils comme neige au soleil ? Pourquoi supprime-t-on des titres ? C’est ça la liberté ? La liberté de ne rien choisir ? {…} La seule vraie liberté c’est le fait qu’en payant 1 CHF par jour et par ménage, on peut tout produire, tous les domaines, tous les contenus. Tous les publics sont légitimes, même ceux qui sont très minoritaires. On met tout sur la table et vous choisissez ce qui vous intéresse. À la fin, ça coute moins cher que la somme de tous les abonnements ».
Pour résumer
Les deux camps s’opposent fortement sur leur vision respective de la liberté. Là où les initiants promeuvent en particulier la liberté individuelle absolue et la liberté d’entreprise qui permettraient respectivement aux individus et aux entreprises de déployer optimalement leurs projets, les opposants soutiennent la liberté égalitaire ou sociale, se rapportant à une maximisation des choix possibles pour le plus grand nombre en fonction de leurs moyens financiers. De plus, un autre point de vue sur la liberté fut abordé, s’éloignant des considérations basées sur le citoyen : celle de la liberté journalistique. M. Brélaz et M. Crittin ont exemplifié leurs préoccupations à propos d’émissions comme À Bon Entendeur et leurs tests de produits commercialisés par de grandes entreprises, ou Mise au Point et leurs sujets délicats. Elles ne peuvent produire ces contenus qu’à condition d’une indépendance journalistique totale, possible grâce au financement public. Jutzet y répond par le cas de l’affaire Buttet, sortie dans le Temps. L’implication de l’État, plus que de l’entreprise, influence l’objectivité de la SSR. C’est d’ailleurs avec ces observations qu’un autre fossé s’observe entre les deux camps : l’appréciation de la puissance étatique et de la puissance privée, qu’une analyse du débat alternative pourrait faire ressortir.
Etienne Furrer
[1] Bien que la parité politique fut respectée, on ne peut en dire autant de la parité homme-femme, ce qui fut, à biens des égards, indépendant de notre volonté.
[2] Pour plus d’informations sur les détails de l’argumentation, vous trouverez une profusion d’interventions et de résumés journalistiques sur internet.
[3] Uwe Poerksen, Plastic Words, The tyranny of a Modular Language, The Pennsylvania State, University Press, 1995.
[4] Marcel Aymé, Le confort intellectuel, Paris, Éditions Flammarion, 1949, p.51.
[5] Loin de moi l’idée de faire une caricature de l’étudiant HEC. Cet étudiant typique n’existe pas. Cependant, le modèle de l’homo œconomicus ne fait encore pas parti du passé dans les facultés d’économie, malgré les nombreuses critiques que lui adressent économistes et sociologues.
[6] Je me réfère, par ce jeu de mot, au principe d’économie d’échelle, bien connu des économistes. « Il y a économie d’échelle quand le coût moyen de production baisse au fur et à mesure que la taille de la production augmente » dans Jean-Paul Betbèze, Les 100 mots de l’économie, Paris, PUF, 2016, p. 24. Pour la SSR, la taille de la production ne peut pas augmenter (la Suisse), donc ne peut facilement baisser ses coûts. Seule une entreprise plus grande (internationale) pourrait baisser les coûts de production, au risque de perdre en qualité – ce qui ne représente pas une règle générale, mais plutôt une probabilité plus forte induite par la difficulté à surveiller la production.
[7] Agence télégraphique suisse
[8] La SSR s’étend sur l’ensemble du territoire suisse à l‘aide de nombreux bureaux régionaux, dont plusieurs fonctionnent à perte.