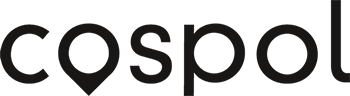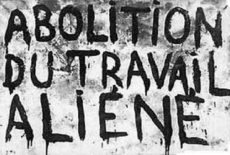Penser l’opinion publique
Peinture de Victor Varacalli.
Dans L’opinion publique n’existe pas, Bourdieu n’a pas pour visée (explicite) de « dénoncer de façon mécanique et facile les sondages », mais se propose plutôt d’en analyser les fonctions et leurs fonctionnements (Bourdieu, 1984: p. 222). Pour ce faire, il propose de réfléchir notamment sur les questions adressées par les sondages ainsi que les réponses que produisent les sondés. Il en vient à s’interroger sur la façon dont les sondages sont utilisés par les pouvoirs publiques, avec pour fonction principale de construire un problème social sur lequel il serait légitime de sonder « l’opinion publique ». Dans la mesure où celle-ci s’exprime dans le sens souhaité, elle devient un gage de légitimation de l’entreprise politique qui se voit ainsi renforcée. De sorte que, l’opinion publique devient un « artefact dont la fonction est de dissimuler que l’état de l’opinion à un moment donné est un système de forces » (ibid : 224). En effet, le sondage d’opinion laisse à penser qu’il existe une opinion publique unanime, alors qu’elle ne fait que dissimuler les rapports de force qui la fonde. L’auteur du texte, en se focalisant sur une analyse qualitative des questions et des réponses, constate que les prises de position des enquêtés sont socialement situées, ce qui détermine largement le rapport qu’ils entretiennent aux problématiques suggérées voire imposées par les sondages. Dans cette perspective, nous pourrions remettre en cause la légitimité attribuée par certains intéressés, au concept communément appelé d’opinion publique. Afin d’y réfléchir, nous allons nous focaliser sur les trois axes de la critique proposée par Bourdieu dans le texte sus-mentionné. Nous verrons dans un premier temps comment l’auteur déconstruit le postulat selon lequel « la production d’une opinion est à la portée de tous » (Bourdieu, 1984 : 222). Il s’agira ensuite de désamorcer un deuxième postulat qui suppose que toutes les opinions émises se valent (ibid). Enfin, un dernier postulat, implicite celui-ci, qui sous-entend en posant une même question à large échelle, qu’il y a consensus tant sur la problématique sous-jacente à la question posée que sur sa légitimité (ibid).
C’est lors d’un exposé fait à Noroit [1], que Bourdieu annonce la couleur de sa critique. « Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique » (ibid), ce dernier constate, en s’appuyant sur de nombreux entretiens, que tout le monde n’a pas une opinion. Or, les enquêtes menées par les instituts de sondage, produisent l’illusion que tous les citoyens ont une voix, la fameuse Vox Populi athénienne qu’il faut, dans un État digne d’être qualifié de démocratique, respectueusement suivre. Cependant, Bourdieu s’évertue à démystifier cette « Vox », car il semblerait qu’elle ne soit composée que d’une certaine partie des citoyens, notamment ceux qui sont les plus à mêmes d’émettre une opinion. Cette partie de la population, loin d’être totalement homogène, partage néanmoins un certain type de propriétés sociales. En effet, de nombreux travaux en sciences sociales montrent que les individus les plus dotés en capital culturel ou économique, sont largement ceux qui participent le plus aux enquêtes d’opinion (nous y reviendrons par la suite). Ici, un parallèle entre les enquêtes de sondage et les votations électorales peut être effectué quant à la composition sociographique des participants à ces deux modes d’expression institutionnels, car il semblerait que les logiques et les dynamiques à l’œuvre se reproduisent avec une régularité significative.
C’est tout le travail de D. Gaxie dans le Cens caché, qui tente de mettre en exergue ces phénomènes sociaux. En résumé, son constat montre que l’abstention est fortement corrélée à l’intérêt pour la politique et au sentiment de compétence politique, eux-mêmes tributaires du niveau d’instruction des individus. Le « cens caché » serait donc lié à une distribution inégale du capital culturel au sein de la population. Ainsi, nous dit Gaxie, les individus se sentent « désarmés sur un terrain qu’ils jugent dangereux, [de sorte que] les plus démunis [opposent] une forme de résistance silencieuse au pouvoir de la parole » (Gaxie, 1990 : 98). Ce sentiment d’incompétence, semble à plusieurs égards se traduire en sentiment d’illégitimité que les sondés ressentent au moment d’émettre leur opinion, au même titre que lorsqu’il s’agit de se rendre aux urnes. Donc comme le taux d’asbstention, le nombre de « sans réponses » n’est aucunement représenté lorsque les sondages sont rendus publics. D’ailleurs, note Bourdieu, « la première opération, qui a pour point de départ le postulat selon lequel tout le monde doit avoir une opinion, consiste à ignorer les non-réponses » (Bourdieu, 1984 : 225) comme, ceteris paribus, l’on ignore les votes blancs. En vue de démontrer qu’il existe des participants qui n’ont pas d’opinion, l’auteur propose l’exemple suivant: « vous demandez aux gens: êtes-vous favorable au gouvernement Pompidou? Vous enregistrez 30% de non-réponses, 20% de oui, 50% de non. » (ibid). L’absence de considération pour les 30% de non réponses, implique un choix qui est « une opération théorique d’une importance fantastique » (ibid). En effet, cette opération pose de sérieuses questions quant à la représentativité du résultat que propose l’enquête d’opinion. Le résultat prétend représenter l’opinion publique comme étant la simple agrégation d’opinions individuelles. Ceci contribue à produire un effet de consensus (ibid) qui laisse croire à une certaine unanimité de l’opinion publique. Cependant, une telle opération fait fi de tous ceux dont on n’a pas entendu la voix. Bien que les instituts de sondage invoquent des techniques tendant à prouver la neutralité ainsi que la scientificité de leurs procédés, l’analyse scientifique des échantillons utilisés ainsi que l’interprétation des réponses qui leurs sont affiliées, laissent penser le contraire. L’analyse informe sur « la catégorie considérée qui est définie non seulement par le taux de probabilité de réponse mais aussi par la probabilité d’en obtenir une opinion favorable » (ibid : 225-226). Ceci rejoint un problème formel relevé par Patrick Lehingue, professeur de Sciences Politiques à l’Université de Picardie, concernant le non respect des quotas de la part des interviewers, qui ont « tendance à se porter spontanément vers les milieux les plus aisés » (Lehingue, 2007 : 102).
Par conséquent, l’opinion publique, comme somme d’opinions individuelles, semble être un axiome qui relève de l’utopie. Dès lors, tout ceci tend à déconstruire le mythe du sondé comme autonome et compétent lorsqu’il s’agit d’émettre une opinion individuelle, « situation qui est au fond celle de l’isoloir, où l’individu va furtivement exprimer dans l’isolement une opinion isolée » (Bourdieu, 1984 : 231). Bien que Bourdieu ne s’attèle pas à dénoncer explicitement le manque de représentativité, Lehingue dénonce les pratiques tendant à surinterpréter systématiquement des « réponses de complaisances [qui] pénalisent ou défavorisent les individus les moins richement dotés à qui l’on fait dire plus ou autre chose que ce qu’ils pensent ou sont à même de dire vraiment » (Lehingue, 2007 : 174). Ainsi, sous le postulat de l’opinion communément partagée, le sondage montre en réalité de grandes faiblesses en terme de représentativité. De fait, l’opinion publique ne relève que de la voix de ceux que l’on entend le plus dans l’espace publique, en d’autres termes, ceux dont l’opinion revêt une force. Car, nous dit Bourdieu, « la probabilité d’avoir une opinion varie en fonction de la probabilité d’avoir un pouvoir sur ce à propos de quoi on opine » (ibid : 232). De surcroît, il existe une inégalité qui se manifeste dans le rapport aux questions, car « la capacité à émettre une opinion sur un problème dépend de son degré de réalité pour les personnes interrogées » (Gaxie, 1978 : 111). Tout ceci est en partie le fruit d’un sentiment d’incompétence à produire une opinion sur certains sujets de la part des « sans réponses », qui représentent ainsi une grande importance, mais qui sont laissés pour compte par les différents sondages.
Ceci nous amène à nous questionner sur les réponses qui sont effectivement produites par les sondés. Alors que nous avons montré qu’en réalité, tout le monde n’avait pas la capacité de produire une opinion, contrairement à ce que laissent sous-entendre les nombreuses enquêtes, nous verrons que les opinions fournies ne se valent pas. Bien qu’il ne soit aucunement question de hiérarchiser les opinions, de nombreuses études montrent que les réponses données varient en fonction de la position structurale (elle-même inscrite dans une certaine trajectoire sociale) de ceux qui les produisent. En effet, « la nature des réponses, dépend entièrement du principe à partir duquel elles sont produites, [c’est-à-dire en fonction de] l’opposition entre deux principes de production des opinions: un principe proprement politique et un principe éthique » (Bourdieu, 1984 : 229). En effet, les réponses produites reflètent des schèmes de perception du monde que les auteurs de ces réponses ont intériorisées et qui sont pour une grande partie constitutifs de leur rapport au politique. A fortiori, celui-ci varie en fonction de la position occupée dans le monde social. Et ce que constate Bourdieu, c’est que des problèmes qui peuvent relever du politique pour les classes supérieures, sont « d’autant plus perçus comme des problèmes éthiques qu’on descend davantage dans la hiérarchie sociale » (ibid : 226). En d’autres termes, si toutes les opinions ne se valent pas, c’est bien parce qu’elles sont produites en fonction des différences de perceptions du monde social. Dans bon nombre de cas, note Bourdieu, les enquêtes d’opinion présentent un effet pernicieux consistant à « mettre les gens en demeure de répondre à des questions qu’ils ne se sont pas posées » (ibid). De plus, les enquêtés ne pourront produire le même type de réponse en ce qu’ils ne présentent pas le même degré de finesse de perception quant aux problématiques en question, ce qui est fortement lié tant à la position sociale qu’au niveau d’instruction (ibid : 227).
Le premier principe proprement politique, est « ce qu’on peut appeler la compétence politique » à partir de laquelle les agents produisent une opinion » (ibid : 226). Cependant, les agents sociaux sont « inégalement politisés parce qu’ils sont inégalement compétents politiquement » (Gaxie, 1978 : 105) et Bourdieu d’ajouter que l’« on prend les positions que l’on est prédisposé à prendre en fonction de la position que l’on occupe dans un certain champ » (Bourdieu, 1984 : 231). Les opinions que les sondés donnent ne sont par conséquent, pas toujours qualifiable de proprement politique. En effet, les réponses données peuvent comme nous l’avons vu, prendre un caractère moral voire éthique, alors que le sens de la question relève du politique. La capacité à percevoir une problématique comme relevant du caractère politique dépend du niveau d’instruction (ibid : 226).
Ainsi, Bourdieu relève deux conditions pour répondre adéquatement à une question qualifiable de « politique »: il faut tout d’abord être capable de la constituer comme telle ; puis, savoir lui attribuer des catégories proprement politiques, ces dernières plus ou moins adaptées en fonction du degré de finesse de perception (ibid : 227). En outre, l’auteur relève un deuxième principe contribuant à engendrer une opinion, qu’il appelle l’« ethos de classe » (ibid). Ce dernier, se caractérise comme étant un « système de valeurs implicites que les gens ont intériorisées depuis l’enfance et à partir duquel ils engendrent des réponses à des problèmes extrêmement différents » (ibid : 228). En somme, un concept proche de l’habitus de classe, constitutif d’un rapport au politique partagé avec d’autres agents issus d’une même classe sociale. Ainsi, l’ethos de classe, prédispose les individus à produire des opinions qui présentent une logique et une cohérence par rapport aux schèmes de perceptions du monde qui caractérisent leur position structurale. Mais l’ethos de classe n’est pas immuable et les réponses produites par les répondants obéissant à cet ethos, peuvent varier en fonction de leur inscription dans une trajectoire sociale ascendante comme descendante ou en fonction des enjeux de luttes plus ou moins perceptibles, mais souvent inconscients, qui se manifestent dans les rapports sociaux (ibid : 231). Tout ceci, tend à démontrer que les opinions émises par les répondants ne sont jamais détachées des conditions sociales de leur production, ce qui contribue inéluctablement à la production de réponses inégales parmi les enquêtés.
Ainsi, l’hypothèse d’un accord sur les questions qui mériteraient d’être posées, semble relever de l’illusion. La première raison est que « les questions posées dans une enquête d’opinion ne sont pas des question qui se posent réellement à toutes les personnes interrogées et que les réponses ne sont pas interprétées en fonction de la problématique par rapport à laquelle les différentes catégories de répondants on effectivement répondu » (ibid : 230). Il y a par conséquent un effet d’imposition de problématique, dont les sujets et les enjeux sont très inégalement maitrisés par les différents groupes sociaux, entre autres pour les raisons mentionnées plus haut. Comme le montre D. Gaxie lorsqu’il pose la question qui consiste à « savoir s’il faut plus de libéralisme, plus de la moitié des personnes interrogées répond en réalité à une autre question que celle qui leur est posée » (Gaxie, 1990 : 122). C’est donc souvent par le biais de ces sondages que s’impose une problématique dominante, « qui intéresse essentiellement les gens qui détiennent le pouvoir » (Bourdieu, 1984 : 230). De sorte que les détenteurs du pouvoir s’appuient sur ces sondages en vue de connaître les tendances et d’ainsi orienter leurs actions politiques. Ces tendances, comme nous l’avons esquissés plus haut, sont pour une grande part représentatives de ceux qui sont le plus à même d’émettre une opinion et dont la force a une portée plus significative sur l’espace public. Dès lors, on comprend bien pourquoi ces sondages peuvent relever d’une grande importance pour les acteurs publiques, à l’heure d’organiser leur entreprise politique. Un autre problème que présentent ces enquêtes, est que les questionnaires soumis aux enquêtés, sont fondés sur la base de questions fermées, ce qui tend à homogénéiser de fortes différences sociales entre les répondants.
Ce sera l’une des principales critiques avancées par Lehingue. qui avance le fait qu’il faille laisser certaines questions ouvertes (ce que propose également D. Gaxie). Il s’agit dans ce cas de demander par exemple, « aux répondants quelles significations ils donnent à tel terme ou à telle formulation, pour que cessent d’être surinterprétées des réponses qui n’ont pas toujours valeur de jugement politique tranché, et pour que cessent d’être détournées voire dérobées des réponses qui ne répondent pas toujours aux questions posées » (Lehingue, 2007 : 169). L’imposition d’une problématique a donc pour effet majeur de donner l’illusion que les questions posées sont celles qui regardent l’ensemble de la société et qui vont de soi. Il arrive donc que les personnes interrogées, de part la violence symbolique que peut représenter le sentiment d’incompétence politique, s’attèlent à bricoler des réponses en vue de faire bonne figure. Le problème est que ces pratiques de productions de réponses à des question qui sont posées comme légitimes, mais dont les répondants ne se sont jamais interrogés sur leur fondement, contribuent à fausser les résultats des enquêtes et participent à l’effet d’homogénéisation que produisent ces sondages. De fait, ces enquêtes imposent une grille de réponse politique à des réponses qui ne le sont pas. Rémy Lenoir, professeur de sociologie à l’Université de Paris 1, analyse la tendance à construire un fait social comme étant un « problème social ». Il s’agit pour ce dernier d’un « véritable travail social, dont les deux étapes essentielles sont la reconnaissance et la légitimation du problème comme tel » (Lenoir, 1996 : 77).
Il semble que les enquêtes d’opinions et l’effet d’imposition d’une problématique légitime qu’elles induisent, contribuent à produire de nouvelles catégories de perceptions du monde social, reconnues comme communément partagées et de ce fait légitimées. D’ailleurs, cette reconnaissance publique du problème social, implique un processus de légitimation favorisés par les différents discours, qui eux prennent appui sur la force que représentent ces nombreux résultats d’enquêtes d’opinions. En effet, Bourdieu le souligne en disant que « tout exercice de la force s’accompagne d’un discours visant à légitimer la force de celui qui l’exerce » (Bourdieu, 1984 : 224). « L’instrumentalisation » des sondages par les pouvoirs politiques en vue de légitimer leurs actions politiques, consiste à dire que « l’opinion publique est avec [eux] », comme s’ils disaient pour appuyer leur discours que « Dieu est avec [eux] » (ibid : 224). Ainsi, les problématique abordées par les sondages d’opinion, sont « profondément liées à la conjoncture et dominées par un certain type de demande sociale » (ibid : 223). En d’autres termes, ces dernières sont régulièrement subordonnées aux intérêts politiques, ce qui influence fortement tant la signification des réponses que l’interprétation des résultats, et fait ainsi du sondage d’opinion un réel « instrument d’action politique » (ibid : 224). La force que représente la mise à l’agenda d’un « problème social » relevé lors ses sondages d’opinion, est un aspect non négligeable en même temps qu’il constitue une ressource essentielle pour les pouvoirs publiques en terme de légitimation de leur politique. Cependant, il ne s’agit pas de tomber dans un rejet radical et systématique de toute étude statistique. Une vision manichéenne tendant à diaboliser les instituts de sondage, ne relève pas d’une méthode de critique rationnelle sur l’usage de ces études. Olivier Martin, professeur des Universités en sociologie à l’Université Paris Descartes, souligne que l’attitude radicale tendant à dire que l’« on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres », relève d’une attitude extrême qu’il faut rejeter (Martin, 1997 : 175). Ce qui importe au contraire, c’est d’adopter une « attitude critique raisonnable face aux informations statistiques, en soulignant les aspects arbitraires de leurs élaborations et interprétations comme la relative solidité de leur fondation » (ibid). Ce qui n’empêche pas Bourdieu de conclure quant à lui que « l’opinion publique n’existe pas, sous la forme en tout cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence » (Bourdieu, 1984 : 234).
Boris Colinas
SOURCES
– Daniel Gaxie, « Au-delà des apparences » in Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 81-82, 1990, pp. 97-112.
– Daniel Gaxie, « Le Cens caché » in Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris : Seuil. 1978, pp. 96-122.
– Olivier Martin, « Les Statistiques parlent d’elles-mêmes. Regards sur la construction sociale des statistiques » in Club Merleau-Ponty, la pensée confisquée, Paris : La Découverte. 1997, pp. 173-191.
– Patrick Lehingue, « Marges d’erreurs, erreurs à la marge ? L’instrument est-il précis ? » in Subunda. Coups de sonde dans l’océan des sondages, Bellecombe-en Bauge: Ed. du Croquant. 2007, pp. 57, 102-110 et 169-175.
– Pierre Bourdieu, « L’opinion publique n’existe pas » in Questions de sociologie, Paris : Minuit. 1984, pp. 222-235.
– Rémi Lenoir, « Objet sociologique et problème social » in Initiation à la pratique sociologique, Paris : Dunod. 1996, pp. 53-77
[1] Exposé fait à Noroit (Arras) en janvier 1972 et paru dans Les temps modernes, 318, janvier 1973, pp. 1292-1309.